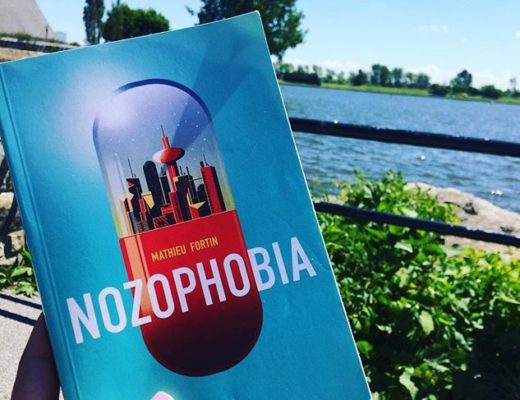Panéliste lors d’une table ronde sur la place des femmes en littérature au Salon du livre de Montréal 2020, invitée dans les studios de l’émission Plus on est de fous, plus on lit, son premier roman étant déjà en réimpression après seulement quelques mois sur les tablettes de nos librairies, Caroline Dawson a su se faire une place remarquée dans la sphère littéraire québécoise avec la parution de Là où je me terre.
Nous ne cacherons pas que nous avons tous et toutes, au sein de Page par Page, un lien spécial avec cette autrice, puisqu’elle a fait partie de nos collaboratrices pendant plusieurs années et demeure engagée dans l’organisation du Festival de littérature jeunesse de Montréal et ses initiatives comme la Quarantaine d’histoires, présentée au début de la pandémie. Bien entendu, Là où je me terre a créé une vague d’enthousiasme parmi les collaboratrices et collaborateurs de Page par Page. Aussi, ils et elles ont décidé d’écrire un article conjoint sur ce qui semble bien être une des plus belles parutions de 2020!
Les mots de Françoise Conea
Réfugiée chilienne, Caroline Dawson n’a que 7 ans lorsqu’elle arrive à Montréal en 1986. Dans ce récit, elle nous décrit son parcours d’immigrante modèle : ne pas détonner pour être mieux acceptée, s’effacer pour éviter d’être pointée du doigt. C’est avec limpidité qu’elle nous parle de choc culturel, de déracinement et d’identité. C’est avec révolte qu’elle nous livre son expérience des préjugés, du racisme et de la discrimination. « La langue de la domination de ma mère était désormais devenue mon terrain de jeu. » Un premier roman à la fois lumineux et émouvant.
***
Les mots de Valérie Léger
Dans ce premier roman, Caroline Dawson nous offre un récit généreux et d’une authenticité désarmante. Le livre débute lorsque Caroline et sa famille immigrent au Canada en 1986. Dès les premières pages, le récit nous emporte. Chaque chapitre raconte une anecdote bien précise ayant été marquante dans le cheminement de la petite Caroline jusqu’à sa vie adulte. Ces anecdotes, bien que très personnelles, réussissent à nous faire ressentir des émotions d’une puissance incroyable et nous poussent à réévaluer notre monde et nos valeurs. On y trouve également un certain humour, une luminosité et un souci du détail jusque dans les titres des chapitres. Tout cela en fait un incontournable des récentes parutions littéraires.
***
Les mots de Vicki Milot
Le 25 décembre 1986, une famille chilienne débarque au Québec pour fuir le régime de Pinochet. Parachuté à l’hôtel Ramada, lieu de passage des réfugiés politiques, le clan Dawson s’agglutine dans sa chambre en attendant ses papiers. C’est via le regard de leur fillette, Caroline, qu’on apprivoise cet exil. Comme elle, on se gave de chaque petite parcelle d’espoir, comme elle, on se prend à adorer cette « maîtresse d’école » qui distribue des céréales chaque fois qu’un élève décode un mot de français. Voici un court extrait qui évoque les premiers pas de Caroline à l’école :
Nous étions dix-sept enfants, de toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs des gens qu’on appelle les « minorités visibles ». Pas de Blancs dans la classe, mis à part la maîtresse. Il a fallu désapprendre à l’appeler Madame-La-Professeure, comme nous le faisions dans nos pays respectifs. Elle n’avait pas de nom de famille. Ça devait être quelque chose comme Beaulieu, Ouellet ou Gaudreault. Pour nous, les enfants d’immigrants de la classe d’accueil de l’école primaire La Visitation, proche du boulevard Henri-Bourassa, elle se nommait madame Thérèse.
– p. 49.
***
Les mots de Noémie Philbert-Brunet
La petite Caroline est devenue écrivaine et ne se fait plus silence. Avec Là où je me terre, Caroline Dawson nous livre un récit intime : une histoire qui rappelle celle de beaucoup d’autres familles immigrantes qui tentent de gravir les échelons de la réussite sociale. Elle nous parle des sacrifices d’une mère, de l’adaptation d’une famille immigrante à un milieu aux codes radicalement différents. Un livre essentiel qui permet de mieux comprendre une réalité méconnue.
Mon intégration d’enfant immigrante a passé par la honte de ce que j’étais, le rejet de ce qui me constituait et une série de petites trahisons envers moi-même et mes parents. J’ai commencé à ne me concevoir qu’à travers les yeux des autres, en tentant d’anticiper leurs réactions. J’avais huit ans et j’avais déjà interdit à ma mère de mettre des trucs pouvant être perçus comme exotiques dans mes lunchs, m’aliénant ainsi à ma culture d’origine.
– p. 69
***
Les mots de Patrice Sirois
Là où je me terre réussit à transformer un drame intime et personnel en récit où tout le monde se retrouve. Bien que nous ne sommes pas tous dans les mêmes souliers exilés de la petite Caroline, les émotions sont tellement franches qu’on ne peut que les ressentir à notre tour. Le malaise enterré, l’impression de jouer à l’imposteur et le déséquilibre nous hantent tous et toutes, mais seule Caroline trouve toujours la douceur juste pour nous bercer dans le naufrage.
Sur le qui-vive, j’ai passé mes journées à perfectionner mon numéro, à peaufiner mon personnage. Je continuais mon manège même si je n’étais pas observée, même dans l’obscurité. Ma prestation était irréprochable. À la nuit tombante, j’étais exténuée. Pour éviter que ça se reproduise, j’ai poli tout ce qui pouvait attirer l’attention. Effacé ce qui sortait de leur normalité. Nettoyé ce qui ne faisait pas partie de leurs points de référence. Le fardeau de la preuve reposait sur la petite immigrante de neuf ans en costume de bain jaune une pièce, qui frissonnait dans le demi-jour sous les néons intermittents de la piscine Morgan. J’ai donc appris à me tenir dans la pénombre, à vivre à contre-jour, à mener une vie reflet. À ne plus jamais lever les bras au ciel.
– p. 89
***
Les mots de Karine Fortin
Par les observations fines d’une écrivaine qui regarde les choses en face, j’ai ressenti avec acuité la peur d’une personne analphabète devant les mots et l’ambivalence, la honte, le rapport conflictuel à la langue d’une personne immigrante dont la langue maternelle n’est pas le français. Caroline aborde sans peur des choses qu’on préfère garder cachées, elle déterre là où elle et on se terre.
Aujourd’hui, quand j’entends mon fils parler parfaitement le français et le suédois, quand je le vois déjà s’intéresser à l’anglais, mais répondre timidement et avec une pointe d’agacement à une question en espagnol, j’ai honte. Pas de lui, qui accueille les mots avec faim et candeur, mais de moi qui n’ai pas su dépasser l’embarras et l’opprobre reliés à ma langue maternelle. À trois ans, il avait déjà compris que cette langue n’était que chuchotements subalternes. Je la cachais, la murmurais en étrangère ne voulant pas se faire démasquer, la gardais secrète entre nous pour nous dire que nous nous aimions, mais aussi pour ne pas nous faire repérer. Une langue tanière qui bat en retraite.
– p. 188
***
Les mots d’Ariane Leduc
J’ai été happée de plein fouet par les mots de Caroline Dawson dès le début de la lecture de ce roman. J’ai versé mes premières larmes à la page 22, alors que Caroline raconte comment sa mère, qui devait planifier les mille et un détails de l’exil de la famille un 24 décembre, a quand même pensé à ajouter une Barbie toute neuve dans les valises parce que Noël ne prend pas de pause, même en plein exil politique. Ce furent mes premières larmes, mais non les dernières provoquées par ce roman qui m’a saisie et touchée de bout en bout.
J’ai ressenti ce profond déchirement entre la culture d’accueil et celle du pays d’origine. Une lecture marquante et nécessaire, un formidable hommage aux sacrifices énormes que font ceux qui quittent tout pour tenter de bâtir une vie meilleure à l’autre bout du monde.
Je ne retournerais pas au Chili avant l’âge adulte parce que je ne voulais pas vivre de nouveaux deuils. Je détestais les départs et me suis longtemps sentie incapable de vivre la distance sociale et culturelle qui s’imposait peu à peu entre moi et mes parents. J’ai surtout compris que le français devenait ma langue. Celle qui se superposerait lentement à l’espagnol, pourtant première et maternelle. Celle qui deviendrait une demeure. Celle qui me permettrait non seulement de dire, d’appréhender le monde mais aussi de m’éloigner des miens. De m’éloigner des miens sans les quitter. »
– p. 111-112
***
Les mots de Karine Villeneuve
Les grands romans enseignent à vivre : aimer, comprendre, questionner, dénoncer et surtout embrasser l’autre dans tout ce qu’il est, dans toutes ses ressemblances et ses différences, surtout ses différences. Nous avons tous besoin de littérature pour mieux saisir le monde, pour mieux nous l’expliquer et pour mieux aller nous amuser avec lui. Je me sais lire un grand roman quand il se mue en grand moment. Là où je me terre de Caroline Dawson marque assurément d’une pierre précieuse le moment où j’ai tenu ce roman entre mes mains.
L’écriture y est juste, sensible et évocatrice. Il n’y a pas un mot de trop dans ces deux-cents pages. J’y ai vu un travail d’édition rigoureux, amoureux de son autrice. Et que dire du titre, doux Jésus!, sinon qu’il est exquis. Il se déplie comme de l’origami. Il est fin comme du papier de soie. Le regard que pose Caroline sur la femme, sur la diversité des conditions féminines est bouillonnant de lucidité surtout en constatant tout le travail qu’il nous reste encore à abattre.
Une grande percée du féminisme a été de libérer les femmes blanches d’une partie des travaux domestiques pour les faire exécuter par d’autres femmes, immigrantes comme ma mère, qui se tapait la double tâche d’être à la fois ménagère chez elle et subalterne dans les foyers huppés.
– p.136
Je bercerais à l’infini la petite Caroline pour la réchauffer de l’hiver québécois et j’ai hâte de prendre dans mes bras la grande Caroline pour la féliciter d’avoir écrit un futur classique de la littérature québécoise.
***
- Auteure : Caroline Dawson
- Parution : automne 2020
- Nombres de pages : 208
- Maison d’édition : Les éditions du Remue-Ménage
Crédit photo : Valérie Léger